chapitre 22
Proust à ma table, et alors?
"La poésie peut être la source , pour ceux qui ne connaissent pas ce langage, des plus grands malentendus par les plus grands imbéciles."
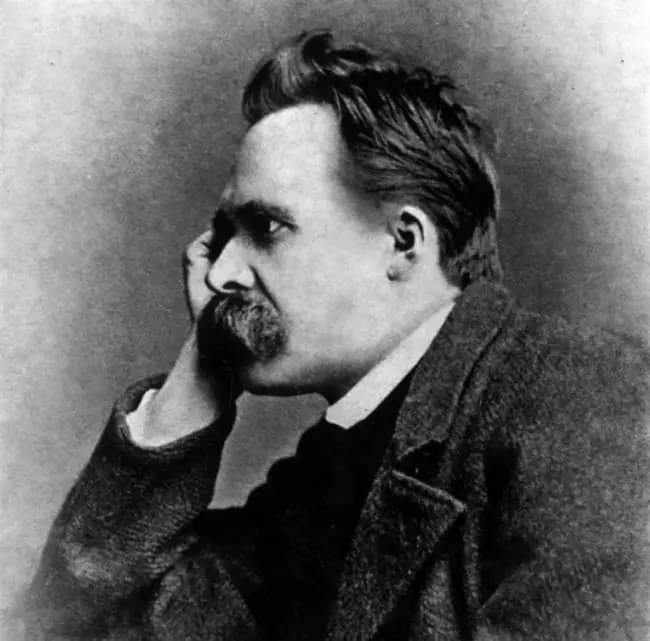
Proust à ma table, et alors?
La poésie peut être la source , pour ceux qui ne connaissent pas ce langage, des plus grands malentendus par les plus grands imbéciles. « Je m’étais assis sur le rebord de la Terre » a permis d’inventer l’argument irréfutable des platistes. Bien sûr, ce ne sont pas des amateurs de poésie qui ont trouvé cette justification. Tout est prétexte chez les complotistes, pour trouver une formule « qu’on nous aurait cachée et qui est bien la preuve que … »
Au moment où j’écris ces lignes, nos sociétés sont contaminées par ces illusions de vérités alternatives et l’impossibilité de redonner à la seule vérité son statut d’arbitre du réel, nous menace d’une déstabilisation générale. A ceux qui me survivront et liront ces lignes, j’ai le sentiment d’être lâche et de vous abandonner à un combat qui sera celui de votre époque. Pour y parvenir, sans renoncer trop tôt, sans désespérer trop vite, je ne vois que cette défense conceptuelle, intellectuelle, culturelle d’exprimer le monde et le rapport de chacun par le biais de l’art, c’est-à-dire la puissance démiurgique de l’imagination, des rêves, et encore une fois, de la poésie.
Très souvent, tard, j’ai essayé d’appeler Marcel. J’avais à la fois des compliments et des reproches à lui faire. Mon papa l’avait bien connu, du moins comme romancier reconnu et apprécié, et l’adolescent qu’il était à cette époque n’imaginait pas mettre un jour un costume semblable à celui du Capitaine Dreyfus. J’ai une certaine fierté de penser à mes grands-parents dans les milieux bourgeois de la Belle époque, dans le fourmillement d’idées graphiques ou architecturales de l’Art Nouveau. Je me dis que, dans les yeux de mon père, un monde est mort, certes, mais un autre est né. Je n’ai pas eu le courage d’écrire leur histoire. Il me manquait trop d’éléments historiques, surtout à cette période de croisements nationaux, patriotiques, ethniques. Et puis il devait y avoir trop de secrets, qu’ils soient politiques, militaires ou familiaux. Et Marcel lui-même, qui pourtant ne rechignait pas à la peine, n’a pas souhaité m’aider. C’était le reproche que je voulais lui faire. Cependant, nageant dans les courants de mots, de phrases, dans les vagues déroulantes de ses métaphores, entendant même clairement dans la musique des mots, les sons des mots de la musique, j’avais plongé dans l’immensité de son œuvre, mais sans crainte, refusant même comme un garçon capricieux de sortir de ce bain idyllique. Comment le remercier. Quand j’appris sa mort (« trop jeune ») j’eus le sentiment d’un gâchis injuste pour la mise en paroles de ce qu’il parait impossible de dire sur le Monde .
Faire la connaissance de Proust avant celle de Sartre a été autant chronologique qu’utile. Après « Les Mots », je pouvais encore pousser le cercueil de Proust vers un Panthéon personnel dont je ne donnerai pas l’adresse. Hélas, ce surplomb terrible de l’art des génies nous fait une ombre où nous n’apparaissons pas plus grands que des fourmis. Et même mon rêve n’a pas eu cette idée facile de m’en faire prétentieusement sa roupie ridicule ni sa crotte égale de sansonnet. Je me réjouis seulement de porter Marcel en second prénom. L’égo sait quand même se tenir et ce qu’il accepte dans ces rêveries douces, c’est au mieux la présence parfumée des dames portant fleur de catleya, l’élégante ouverture du corsage pour une gorge naissante et les coiffures dont l’agencement confirme l’artiste visagiste et le coiffeur virtuose. Avec Marcel tout est harmonie, tout est musique aussi et je me souviens parfaitement de ces opus au cœur de ses pages . Forcément, œuvre fictive, la sonate de Vinteuil fait sonner piano et violon et leurs notes couvrent ce passage de « A la recherche du temps perdu », comme si elles existaient. Comme les écrivains avaient leur palette de mots pour peindre les paysages ou l’imaginaire, la littérature a puisé à tous les arts et réciproquement.
Ainsi, ils étaient présents tout le long du chemin, mes auteurs, mes artistes préférés et ce sont autant de femmes dont j’admirais l’œuvre. Bien sûr, nous n’empruntions pas de sentier chaque jour, il y avait des périodes entières où je négligeais l’art, me laissant « monter ma pente » vers la facilité, le vulgaire, souvent ce qu’on disait être « à la mode ». Ces univers cohabitaient dans mes désirs mais à la manière dont on craint de préférer un de ses enfants. Le plaisir est un piège , même si c’est une nécessité. Dans les nuits où même les rêves touchent à la complexité, il arrive parfois qu’on force le destin onirique pour ne pas hurler dans la nuit l’image horrible du cauchemar .
Que de rêves vains aussi ! Comme tant d’actions dans la réalité, tant d’émotions infondées, à la recherche du drame comme de petits Shakespeare en pyjama.
Le drame, il est arrivé comme cela. Un petit chagrin d’abord, à cause d’une moquerie. Sur mon embonpoint d’orphelin boulimique mais provisoire , sur ma naïveté infantile sur le fonctionnement du corps humain et particulièrement son système reproductif, sur les rejets par les petites filles dont je tombais amoureux, sans aucune décision volontaire. J’aimais, c’est tout. Un cœur trop gros, enveloppé de graisse et de tant de honte. Parfois le chagrin l’emportait, n’ayant plus aucun recours. Alors, je mélangeais tous les médicaments qui trainaient parfois autour de moi, à l’infirmerie, où j’étais devenu un habitué et où je venais vivre les dernières heures de mes « crises de foie. » Mais je ne faisais qu’aggraver mes douleurs ventrales et j’étais à nouveau le sujet des quolibets, petite boule ridicule, pseudo suicidaire, ratée.
Elle est arrivée comme cela aussi, ma dépression. Elle ne m’a pas lâché de quinze à soixante-quinze ans. Car il faut bien en arriver au fond de la toile. A part ces illusions, ces fantasmes, ces délires, ai-je vécu un vrai moment de bonheur ? Pas une heure ou une demi-journée, mais une période, une saison, même au printemps, même en été dans l’océan puissant des vacances ? Je ne m’en souviens pas. Peut-être qu’à force d’imaginer, faire des hypothèses, frôler la paranoïa, je n’ai pas su retenir la douceur de l’existence. Ce n’est pas un hasard si j’ai forcé la métamorphose de ces larves de papillons, tant je sentais leur désir douloureux de changer de peau. Oui, la peau du papillon, plus légère, plus colorée avec ses deux ailes de géants relatifs.
Notre peau de larve adolescente est plus longue à changer et il n’y a pas de métamorphose. Au contraire, les défauts s’appesantissent et même si nos réflexions visent un peu plus loin que nos désirs immédiats, nous conservons dans le siège de notre âme les blocs de plomb que la culpabilité de notre éducation a posé les uns après les autres.
Il y a aussi ce que nous restons tels que nous sommes nés. Sans en vouloir à nos géniteurs, notre regard sur nous-mêmes dans le miroir est parfois celui de la désespérance pour ce qu’on deviendra. Sans être parfaitement certain d’être descendant de juifs, ce que j’éludais facilement, je faisais une réelle fixation sur l’épaisseur de mon nez. J’ai retrouvé dans un roman de Philip Roth, écrivain juif américain, cette obsession nasale : « Ah ! le nez ! ( Ni celui des africains ) « large et noir, (ni celui des hébreux), long et crochu, ( ne rivalisaient) avec ces minuscules merveilles rectilignes dont les narines pointent automatiquement vers le nord dès la naissance. Et restent ainsi pour toute l’existence. » Ce fut un critère de beauté pour toute ma vie. Sans doute n’ai-je pas eu le courage de supporter un amour généreux, une admiration, peut être bienveillante, en tous cas insensée, d’une femme avec un joli nez droit pour un homme avec un gros nez tordu. Je n’ai jamais osé en rencontrer une et encore moins chercher à en séduire.
C’est encore à Philip Roy que j’emprunte un paragraphe de « Portnoy et son complexe », tant il est une description de l’exacte attitude que j’avais à son âge, surtout dans mon désir de plaire aux jeunes filles « de bonne famille européenne » ( celles qu’il appelle les shikses ) :
« Non ! Non ! çà n’est pas possible ! Je vais à la salle de bains, me plante devant la glace et repousse avec deux doigts mes narines vers le haut. De côté , ça n’est pas trop mal, mais de face, là où se trouve ma lèvre supérieure, il n’y a plus maintenant que gencives et dents. Vous parlez d’un goy. Je ressemble à Bugs Bunny ! »
Sauf dans les rêves. Celles qui passaient, aperçues depuis un balcon, depuis une terrasse de café, celles qu’on a croisées en montant un escalier, en sortant d’un magasin, en quittant un autobus. Elles étaient toutes là, disposées à sourire et accepter de parler du malheur du Monde mais aussi des chances de le combattre. Intellectuelles élégantes, dont l’intelligence confortait la beauté du visage ; artistes subtiles et inventives qui vous offraient la nouveauté infinie des gestes esthétiques, un ballet inouï sans mouvement et silencieux, sinon le regard mobile d’astres en astres ; des visages apparemment tristes qui accentuaient la pureté des traits, des sentiments pudiques qui cachaient le besoin du réconfort, dans le creux de l’aile d’un aigle invincible que j’étais devenu.
Parents, enfants, comme nous sommes éloignés par nos nuits et nos jours, nos envies, nos choix, nos croyances. A nous les imposer pour ne pas trahir, à s’armer pour tous ces conflits de loyauté. Amour familial, que de mensonges nous faisons en ton nom. Nous circulons dans nos univers, nos orbites s’éloignant avec le temps et la faiblesse et la lâcheté de ceux qui devaient maintenir ce mécanisme d’étoiles. Je suis de ceux-là. Je suis celui qui rencontre toutes ces beautés au nez de Cléopâtre, et je ne trouverais jamais création plus divinement parfaite que la beauté de la femme. Et puis voilà, il n’y a plus de rôle pour vous pour cette divine comédie musicale. Le dos s’est courbé sans aucun poids pour lui nuire sinon celui des années. Tous les poncifs sur la vieillesse sont à disposition. L’art d’être grand père , vous ne vous y êtes pas préparé. Ce n’est pas faute d’avoir pensé à sa propre tête chenue, sous l’ombrage du feuillage d’un charme, entouré de ses petits-enfants et les émerveillant par des dessins réalisés aussi vite que le conte narré. Les scenarii multiples et imprévisibles n’ont pas permis de réaliser cette image d’Epinal. Il faut dire que tout ce monde s’est éparpillé, comme ces poupées russes qu’on défait de leur contenant. Les chats jouent avec et par petits coups de pattes coquins, les éloignent de plus en plus loin de la poupée mère. Que faut-il faire quand ça ne « colle »pas ? Inventer, imaginer, prévoir un lieu, un moment où l’appel au rassemblement sera tellement impératif que nul n’y résistera ? Je ne le crois plus. Pour moi même d’abord, qui aie abandonné le cours de cette vie.
Par ailleurs, le bon sens vient aux personnes âgées entre deux crises de folie. Le mode de pensée qui détermine que le cerveau a encore quelques aptitudes à réagir en être humain, c’est celui que Serge Ginsburg appelait « l’aquoibonisme ». Devant sa petite boite de médicaments, les prescriptions médicales, les ordonnances ( comme celle du Pouvoir), la simple idée d’un projet minable pour un lendemain sans intérêt, se conclut très vite par un « à quoi bon ? »
Je ne suis pas de ces « anciens » qui ont un but désirable, une œuvre à parachever, des preuves à fournir avant de les perdre, des erreurs à rattraper, des liens à reformer avant la coupure définitive et tant d’autres désirs de vivre pour toutes les raisons du monde. J’ai passé ma vie à voir passer le temps, attendre le suivant, imaginer le prochain, vouloir échapper à un présent pour un futur sublimé et trompeur. Et dans ce laps de temps, j’ai bu jusqu’à la lie les conséquences de mes erreurs. Tellement évidentes maintenant qu’il m’arrive de vouloir me cacher pour qu’on ne me trouve plus. Un à un, je me suis détaché de tout ce qui constituait mon « entourage ». Jamais je n’ai mieux adhéré à cette formule juive : « Heureux d’être malheureux, malheureux d’être heureux ».
Je n’ai pas connu le monde d’André Breton, celui qui m’a vu naître un peu plus tard, et peut aurais-je eu le génie de considérer l’époque de la guerre finissante, comme une chance de réhabiliter l’homme et sa vie d’homme, sur ses trois indispensables piliers qui font sa grandeur et son honneur : la liberté, l’amour et la poésie. En lisant l’extrait « Lumière Noire », alors même que la guerre touche l’Europe par le conflit injuste et meurtrier entre la Russie et l’Ukraine, avec les mêmes cadres abominables et les mêmes idées effroyables des guerres d’expansion nazies, toute sa parole paraît aujourd’hui vaine alors qu’elle est si juste !
Et d’abord,
« Il faudra commencer par enlever à la guerre ses lettres de noblesse . »
Et ensuite,
« Le temps reviendra où la guerre étant passée derrière l’homme, il devra à tout prix se convaincre qu’elle ne doit pas nécessairement se représenter devant lui. On ne saura réprimer alors trop énergiquement les menées du fatalisme et du scepticisme, voire du cynisme , et encore aura-t-il fallu au préalable ôter à ceux qui se targuent de telles attitudes le profit d’argent ou autre qu’ils en escomptent, faute de quoi il n’y aurait, bien entendu, RIEN DE FAIT. Tâche historique digne des meilleurs mais aussi dont l’initiative et les modalités dépendent des conditions de déroulement ultérieur de la guerre actuelle et peuvent tout juste être conjecturées. »
On comprend bien ici le rapport de la guerre avec le passage précédent sur la forme du nez. C’est l’expression «ne voir pas plus loin que le bout de son nez ». Si nous étions en guerre et si j’en avais l’âge, je ne prononcerais pas ces mots de l’abandon de toute volonté de changement, comme « à quoi bon ? ». Toutes ces formules populaires, mais qu’on peut retrouver dans tout langage soutenu, elles sont dans les pensées de ceux dont le destin personnel prime sur le destin collectif. Et il n’y a pas besoin d’être menacé de mort pour choisir son camp. Chaque conflit divise, sépare, prépare les munitions. Et nous mesurons toujours la distance qui nous sépare avec le centre de la bataille. Quand la mort d’un seul proche touche le cœur unanime de toute une population, l’assassinat de mille à mille lieux de notre empathie, ne fait que nous faire froncer un sourcil en évitant d’imaginer la somme des souffrances.
Si nous ne nous habituons pas à notre malheur, nous prenons hélas l’habitude de ne plus compter la multitude des douleurs des autres.
Alors, ne supportant plus ces décomptes macabres, présents, passés et ..à venir, je pense à Yves et à son apprentissage pour ne plus craindre le baisser du rideau, la fonte des neiges ou la coupure d’électricité. Parfois je manipule nonchalamment, avec la désinvolture qui est la preuve de ma dernière puissance, le tube d’anxiolytiques . Je sais que toute cette vie ratée sera effacée et je n’en ai aucune peine. Je ne crains que la souffrance de l’agonie. La mort est aussi un bourreau . Heureusement, on apprend à s’y préparer . Surtout quand la sociale et l’affective ont déjà fait leur œuvre. Pour qui , pour quoi , cette lumière du matin ou ce couché du soleil ? C’est une chandelle d’une synagogue gaspillée sans avoir pu éclairer la salle glacée des prières. Et comme l’oubli arrive si vite, surtout quand vous n’avez laissé aucune trace personnelle ou- pire- laissé de mauvais souvenirs, le temps ne compte plus, enfin.
Vraiment, à quoi bon ?
